Accueil > Université (problèmes et débats) > Dernière station avant l’autoroute - par le Collectif pour une Université (...)
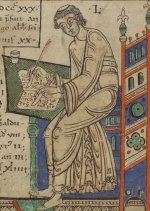 Dernière station avant l’autoroute - par le Collectif pour une Université confédérale, 15 mars 2014
Dernière station avant l’autoroute - par le Collectif pour une Université confédérale, 15 mars 2014
samedi 15 mars 2014, par
À lire de près avant d’aller voter…
Nous nous permettons d’envoyer cette dernière missive avant la période électorale, période pendant laquelle nous nous astreindrons au silence, bien que nous ne soyons aucunement partie prenante dans les élections aux conseils centraux : aucun d’entre nous n’a été contacté par quiconque montant une liste et aucun d’entre nous ne figure donc dans ces listes.
Dans la mesure où les élections touchent directement aux questions de politique universitaire sur lesquelles nous nous sommes engagés, nous souhaitons expliciter la grille de lecture qui sera la nôtre au moment de voter, en dix questions.
1. Quelles méthodes de prise de décision ?
Nous ne doutons pas que chaque liste promettra collégialité et démocratie. Nous serons pour notre part attentifs à la réalité de la chose, en analysant les méthodes réellement utilisées par les candidats par le passé. Ont-ils pris part à des votes "à l’aveugle", non informés, sur des sujets engageant les budgets de l’établissement (par exemple sur la construction de bâtiments ou sur le projet Idex) ? Ont-ils procédé à des votes indicatifs des seuls membres élus pour les décisions transformantes ? Ont-ils au contraire porté des procurations de membres extérieurs pour passer par-dessus la communauté universitaire ? Ont-ils déjà été aux manettes pour procéder, dans la concertation et le calme, à une décision profondément transformante (une refondation sur un nouveau campus, par exemple) ?
2. Quel point de vue sur les PPP ?
Nous ne nous permettons aucun commentaire sur les décisions de justice. Ce qui nous préoccupe, en revanche, c’est l’engagement financier de Paris-Diderot pour ses bâtiments. Le coût d’entretien des bâtiments en PPP est, comme l’ont rappelé la cour des comptes et Mme Fioraso, littéralement exorbitant — équivalents à plusieurs centaines de salaires de collègues Biatss. Pour mémoire, les PPP ont mis sur la paille l’Université de Versailles-Saint-Quentin. Les candidats ont-ils voté en faveur de bâtiments en PPP ? L’ont-ils fait, en sachant qu’il y aurait une plainte de la part de personnes dont la compétence en matière de normes de sécurité est avérée ? Ont-ils pris connaissance du contrat qui sanctuarise la part budgétaire versée à Vinci pour l’entretien des bâtiments ? Les candidats comptent-ils dénoncer les PPP de Paris-Diderot, comme cela a été fait à Toulouse ?
3. Une couche de mille-feuille bureaucratique en plus ou en moins ?
Suite aux amendements à la loi ESR lors de son adoption par le Sénat, l’Université doit choisir entre deux formes de regroupements : la ComUE et l’Association. Ces deux formes permettent toutes deux la coopération entre établissements en matière de recherche, de formation et de vie étudiante. Ce qui les distingue, c’est la création, dans le cas de la ComUE, d’un nouvel établissement à qui des compétences sont transférées, et dont les décisions s’imposent aux établissements de par la loi, quels que soient les statuts. Dans le cas de l’Association, les établissements conservent, au contraire, leur personnalité morale et leur autonomie financière. La loi garantit l’égalité entre les établissements associés, et la possibilité d’une délégation tournante pour la signature du contrat de site, dont les CA de chaque établissement votent le volet commun. Les structures décisionnaires de la ComUE sont destinées à casser toute forme de démocratie et de collégialité ; par comparaison, celles des universités de droit commun sont clairement préférables. Les candidats ont-ils fait partie du CA précédent qui n’a jamais procédé à un débat contradictoire permettant de confronter les différentes possibilités offertes par la loi ? Les candidats considèrent-ils que le PRES a été une structure utile, inutile ou néfaste ? Les candidats se prononcent-ils en faveur de la ComUE ou de l’Association ?
4. Quel moyen de lutter contre le morcellement du Grand Paris ?
La loi impose une coordination à l’échelle d’un territoire, qui peut être académique (Paris), supra-académique (l’Ile-de-France), mais en aucun cas infra-académique (SPC). Les candidats proposent-ils, malgré la loi, un modèle de repli identitaire sur le site SPC (laboratoires de site, écoles doctorales de site, financement exclusif de projets endogames, etc.) ? Les candidats proposent-ils, au contraire, des modalités concrètes d’association à la carte, discipline par discipline, avec les établissements franciliens pertinents ? Les candidats visent-ils à satisfaire les injonctions de la loi, en créant un réseau de coopération en matière de recherche et d’enseignement à l’échelle francilienne ?
5. Quelle politique de l’emploi ?
Les candidats ont-ils par le passé voté en faveur des RCE, responsables en partie de la dégradation budgétaire ? Ont-ils favorisé les CDD (et en particulier des CDD surpayés pour occuper des fonctions inutiles) par rapport à l’emploi statutaire ? Ont-ils décidé un gel de postes que le plafond d’emplois n’imposait pas ? Ont-ils développé la valorisation des compétences internes à l’université, ou systématiquement embauché en CDD des collègues venant du secteur privé ?
6. Quelle politique pour les primes et les promotions ?
L’enveloppe budgétaire consacrée aux primes des enseignant-chercheurs est significative. Les candidats comptent-ils utiliser différemment cette somme, en la reversant de manière égalitaire au personnel ou en s’en servant pour résorber la précarité, ou pour atténuer les fermetures de postes ou encore pour résorber les décalages grade-fonction ? Les candidats comptent-ils maintenir une grille d’évaluation pour les promotions des enseignant-chercheurs entièrement basée sur l’activité administrative ? Témoignent-ils d’un reste d’attachement à ce qui constitue l’Université : créer, transmettre et critiquer les savoirs ?
7 Girouettisme, résilience ou compliance ?
Nous ne croyons pas à l’homme providentiel et n’y avons jamais cru. Les idées nous importent bien plus, ainsi que la capacité à tenir un cap et à résister, le cas échéant, aux oukases ministériels. Que dire de candidats que l’on verrait jurer un jour de défendre le modèle confédéral d’organisation universitaire, que l’on verrait quelques semaines après approuver la fusion, et qui se présenteraient devant nous pour défendre une fédération indéfendable ?
8. Quelle stratégie pour le L1 ?
Tous les enseignant-chercheurs le savent — du moins ceux que l’Université intéresse —il y a un problème en Licence. Notre confiance va aux petites équipes d’enseignement, soudées, inventives et solidaires, aux expériences bien plus qu’aux coups de menton auxquels certains feignent encore de croire. Les candidats ont-ils des vues originales sur la question ? Ont-ils en vue un nouveau Plan mirifique auquel le budget consacré par l’université irait alimenter quelque officine privée ou se perdre dans quelques autres sables ? Souhaitent-ils déléguer à une ComUE le soin d’apporter quelques retouches sous Excel aux maquettes et aux mentions ?
9. Université humboldtienne ou Université napoléonienne ?
L’une des logiques des mutations en cours consiste à passer du modèle facultaire, Napoléonien, au modèle Humboldtien, omnidisciplinaire. C’est du reste la seule logique qui a présidé au découpage arbitraire de l’Ile-de-France en "sites". Paris 7 a été humboldtienne, interdisciplinaire, depuis sa création. SPC est un regroupement décidé pour et par la médecine (par J.L. Salzmann et A. Kahn), toutes les autres disciplines étant sacrifiées. En effet, les cohabilitations de formations et les collaborations scientifiques effectives (et non les collaborations fantasmatiques de papier) pour l’ensemble des disciplines non hospitalières de Paris-Diderot se font avec d’autres établissements franciliens. Les candidats défendent-ils une mainmise du secteur santé sur l’université ? Défendent-ils au contraire le développement, dans la logique de la loi, d’une université dans laquelle tous les secteurs disciplinaires puissent trouver leur compte ?
10. Quel rôle donner aux briques de base du système d’enseignement supérieur et de recherche ?
Autre logique de la mutation en cours, l’éloignement toujours plus grand des structures de décision et la « caporalisation » des universités par un cabinet ministériel qui s’est auto-désigné comme le seul représentant de l’État stratège en matière de politique scientifique et universitaire. Nous sommes pour notre part attachés au rôle des unités de recherche et des UFR. Nous défendons en effet que des petites entités mobiles sont plus à même d’innover en matière pédagogique et en matière de recherche que de grosses et lourdes structures. Il n’est qu’à voir le succès du plan Réussite en Licence, à comparer aux initiatives de petits groupes d’enseignement. On peut aussi s’attendre à de magnifiques résultats avec le plan FUN pour le développement des MOOC. Les candidats ont-ils, dans leur action passée, supprimé des postes dans les composantes pour faire gonfler une technostructure centralisée et centralisatrice ? Les candidats souhaitent-ils redonner une autonomie relative aux composantes et aux unités de recherche ? Les candidats souhaitent-ils au contraire transférer le pouvoir de décision pour les grandes orientations en matière de budget, de postes, de mutualisation de formations, de suppression de composantes, de désassociation de laboratoires, à une ComUE féodale ?
Le collectif pour une Université confédérale


